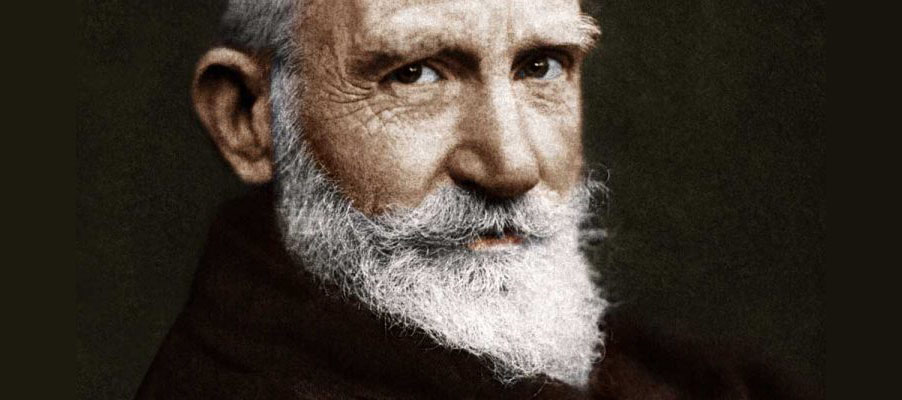
Pourquoi tout est si compliqué, se dit-on parfois. Pourquoi ne pourrait-on pas rester logé dans l’ouverture de My Fair Lady pour l’éternité, serait-on tenté d’ajouter. La vie serait tellement plus simple, heureuse, enchantée. Pour qu’elle nous apparaisse telle quelle le temps d’une soirée, une petite centaine d’abeilles butinent en ce moment dans l’ombre de ce que sera, pour vos beaux yeux émerveillés, la version bruxelloise de My Fair Lady. Retour à l’envoyeur, me direz-vous, puisque c’est ici qu’a vu le jour l’actrice héroïne du célèbre film adapté de la comédie musicale, Audrey Hepburn.
Deux d’entre elles, plus particulièrement, sont à l’affût du moindre détail. On ne les repère pas plus que ça sur les affiches du centre-ville – la comédie musicale est une comédie d’auteurs – pourtant ce sont eux qui sont à la mise en scène du projet. Simon Paco et Jack Cooper remettent le couvert un an après un brillant baptême sur Sunset Boulevard. Quand j’arrive à leur rencontre en cette fin d’après-midi, c’est le début de la deuxième journée dans la journée pour eux et le Karreveld se prend des airs du siècle dernier. Dans la salle des mariages, le casting défile en costume pour la scène de la course d’Ascot. Dehors le décor prend corps. Il fait 32 degrés, nous sommes un lundi d’été 1912.
On est à 20 jours de la première de My Fair Lady. Comment vous sentez-vous? Prêts? Effrayés? Impatients?
Jack Cooper: Bien. Quel beau projet! On a une équipe magnifique, on a des costumes qui vont être incroyables, la scéno bouge de jour en jour, l’orchestre a commencé à répéter aujourd’hui…
Simon Paco: Hier même! Oui, ça va. Il fait chaud et les journées sont longues pour tout le monde, mais ça va aller. C’est un beau projet. On n’est pas en retard. Je suis confiant.
On ne va pas tourner autour du pot. Pourquoi My Fair Lady?
J.C.: Au sein du festival, on souhaite depuis quelques années amener à nos spectateurs francophones les grandes comédies musicales dans ce qu’elles ont de noble et de varié. Après avoir fait La Mélodie du Bonheur qui était un titre assez connu, on a fait quelque chose de plus osé après avec Evita – le thème étant moins drôle – et puis Sunset Boulevard, un ancien rêve de Simon et moi – de nouveau, moins évident pour le grand public – alors cette fois-ci on voulait faire quelque chose de différent en amenant LE grand classique qu’est My Fair Lady. C’est une belle histoire, qui parle des différences de classe, qui reste selon nous toujours actuelle et qui est un spectacle familial. Il remplit donc tous les critères du Festival Bruxellons!
S.P.: Je trouve personnellement que My Fair Lady n’a jamais été autant d’actualité quand on voit le résultat des dernières élections, quand on voit la montée des extrêmes, quand on voit les manifestations répétées des gilets jaunes, etc. Aujourd’hui, on parle beaucoup de racisme, mais presque jamais du racisme de classe, qui est profondément ancré dans nos sociétés – quel que soit le pays – et s’exprime d’une classe aisée envers une classe pauvre. C’est de ça que parle ce spectacle, de ce racisme-là qui est prédominant dans cette Europe en chute.
Quels sont les gros défis de cette mise en scène ?
S.P.: Je pense que toute mise en scène a les mêmes défis de base. À savoir qu’il y a 638 sièges sur lesquels seront assises 638 personnes qui doivent être touchées par ce que l’on propose. Être touché, ce n’est pas seulement être ému, c’est rire, pleurer, comprendre, se questionner, débattre en sortant, etc. Je crois que le défi de tout spectacle est là.
Quand on fait face à un tel monument, monté et récompensé à maintes reprises depuis 50 ans, que reste-t-il à inventer pour le metteur en scène ?
S.P.: Je pense que c’est un peu l’erreur des mises en scène contemporaines, s’obstiner à penser qu’il faut créer quelque chose. Metteurs en scène comme comédiens, je pense qu’on est là pour transmettre quelque chose. Quelque chose qu’ici, on n’a pas l’occasion de voir. Shakespeare est monté depuis bien plus longtemps que ça, quand on y pense. Et quand on veut créer absolument quelque chose de nouveau, on risque souvent de passer à côté de l’œuvre. Surtout, on ne va pas donner la possibilité à des gens qui n’ont jamais vu Shakespeare de voir un vrai Shakespeare.
J.C.: Souvent, on se dit: «Que peut-on apporter à ce spectacle?». On pourrait tout aussi bien dire: «Peut-on apporter ce spectacle au spectateur?». Oui, c’est une œuvre connue. Mais si on demande au public bruxellois, qui a vu My Fair Lady sur scène? À part les spécialistes qui se déplacent expressément pour ça à Londres et en Allemagne, je pense qu’il n’y a pratiquement personne. Quand My Fair Lady s’est-il joué la dernière fois en Belgique francophone?
Paradoxalement, on a l’impression que vous êtes à l’avant-garde d’un courant mainstream. Vous montez des œuvres mondialement connues, mais qui, pour une raison ou une autre, échappent encore à la culture belge et francophone.
J.C.: Exactement. Or, tant sur Evita que sur Sunset Boulevard ou My Fair Lady, l’histoire est extraordinaire! Elle n’a besoin de rien d’autre que d’être racontée. Avec Daniel Hanssens, directeur artistique, comme avec Simon, on ne s’attache à rien d’autre que ça. Le texte. A notre époque, beaucoup cherchent à vouloir réinventer le texte et se croire plus malin que l’auteur. Mais comme quelqu’un l’a déjà dit, le metteur en scène est l’accoucheur, en aucun cas le père. Sur une telle comédie musicale, on compte 12 musiciens, 25 comédiens, 10 créatifs et la fiche de contact de 95 personnes. Le premier défi est de susciter cette équipe.
Dans ce genre de projet, je pense que les metteurs en scène sont avant tout les capitaines d’un navire. Ceux qui combinent le mieux le talent de tout le monde et parviennent à ce que tous ces gens travaillent ensemble au sein d’une communauté et dans une bonne ambiance. Et qu’on aille tous dans la même direction !
Comment coordonne-t-on justement autant d’intervenants et de corps de métier à la fois ?
S.P.: Sur un projet comme celui-ci, chacun construit quelque chose et nous, en tant que capitaines de navire, on est partout. On construit quelque chose avec le main cast, autre chose avec la costumière, autre chose avec la directrice musicale, et encore autre chose avec le scénographe et petit à petit, on met tout cela ensemble et ça donne le projet à 95.
J.C.: Et ce n’est pas toujours évident (sourire).
S.P.: Mais quand les choses se font ensemble, même si le spectateur ne perçoit pas spécialement l’assemblage, inconsciemment il fait: «Waow».
C’est d’ailleurs quand on ne le voit plus que l’assemblage est parfait.
S.P.: Les plus beaux spectacles que j’ai eu l’occasion de voir sont ceux-là. Ceux où ne serait-ce que 30 secondes, tu remarques que tout est assorti. Et cela demande un travail collectif et une harmonie parfaite.
J.C.: L’année passée, que les gens aient aimé ou pas, tout le monde a dit plus ou moins la même chose : les spectateurs avaient rarement vu un spectacle où tout le monde semblait avoir autant travaillé ensemble. Je pense que c’était une des grandes réussites de Sunset Boulevard: sa cohérence. C’est ce qu’on va essayer de reproduire avec My Fair Lady.
Obtenir les droits d’une telle production est parfois un véritable parcours du combattant. Comment cela s’est passé sur My Fair Lady ?
J.C.: My Fair Lady est un classique. C’était très compliqué sur Sunset Boulevard, car c’était une première mondiale en français. Aux yeux des producteurs d’origine, Sunset devait également remplir une série de critères de qualité bien particuliers, car l’auteur et le compositeur sont toujours vivants. Et ces critères sont vérifiés. Si on avait décidé de jouer Sunset sur un navire de guerre en 2100, on nous aurait certainement fait arrêter la production. Tout dépend des œuvres, en réalité. Dès qu’on s’attaque à un Walt Disney par exemple, tout devient super cadré, il y a un code couleur pour les costumes, etc. Sur My Fair Lady, on a plus de latitude.
Plus que l’histoire d’un personnage, My Fair Lady est l’histoire de la transformation d’un personnage: celle d’une simple vendeuse de fleurs en grande dame de la cour. Comment avez-vous adapté le travail sur la langue et l’élocution d’Eliza en français ?
S.P.: C’est très compliqué. La première question était de savoir si on recontextualisait l’histoire en Belgique. Au lieu d’être devant Covent Garden, on serait devant La Monnaie avec une echte brusseleir et un professeur de phonétique qui s’accroche sur la langue française venant du département de la Loire, d’où viendrait probablement le parfait français normatif. La réponse à cette question a été non: restons à Covent Garden.
Mais que fait-on avec l’accent, du coup? Se dirige-t-on, comme on le fait souvent en France, vers un côté un peu Arletty?
Ça ne nous convenait pas non plus.
Une fois l’œuvre traduite, on s’est donc servi des exercices de phonétique du professeur Higgins pour replacer volontairement les erreurs de langage dans la partie qui précède sa formation. Si l’on est très attentif, cela peut ainsi donner à l’écoute un mélange de Liégeois, de Québécois et d’autres choses encore. Mais c’est un accent qui n’existe pas puisqu’il a été créé de toute pièce pour l’occasion.
Un mot pour Olivier Moerens et Daniel Hanssens, dont on parle moins, mais qui œuvrent à maints niveaux dans l’ombre de ce festival ?
J.C.: Olivier a fait un travail énorme sur toute la dramaturgie du spectacle. Pour la plupart des gens, My Fair Lady est une histoire d’amour. Or, l’auteur a explicitement voulu le contraire. Olivier a fouillé toutes les versions, depuis la première de Pygmallion à aujourd’hui, analysé les plus micros changements, les difficultés pendant de longues années à adapter la pièce en comédie musicale, les modifications en douce du script la veille de la première de la première version à l’insu même de l’auteur, quelles scènes ont été coupées et pourquoi… Au-delà du coproducteur, c’est ce travail énorme qui a nourri le nôtre et a permis de mettre en avant la fable sociale qu’est My Fair Lady.
Quant à Daniel, il rêvait depuis longtemps de jouer une comédie musicale, il est donc passé de la mise en scène (Evita, La Mélodie du Bonheur, …) au plateau pour y incarner Aflred Doolittle. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on s’est retrouvé à faire la mise en scène avec Simon. Il a gardé cependant un regard extérieur sur la direction artistique du spectacle et amène lui aussi son expertise et sa palette de connaissances et d’envies sur ce spectacle.
S.P.: Daniel a apporté énormément et d’une manière presque paternelle. Il avait ce côté un peu garde-fous. Il disait un mot et cela suffisait à nous aiguiller dans la bonne direction, vers quelque chose de plus simple, de plus évident ou de plus logique. C’est grâce à son expérience, celle que nous avons moins, que le spectacle a pu aller plus loin.
Pour Olivier, je dirais que nous fêtons cette année les vingt ans du festival. On peut dire ce qu’on veut, mais ce festival n’aurait jamais existé sans lui. Je ne crois pas non plus qu’il aurait tenu sans lui. Olivier s’est toujours battu pour que Bruxellons! soit une famille. Et à travers tout son travail, je pense qu’il a enseigné à beaucoup de gens ce qu’est cette famille et ce que peut être le théâtre.
On l’oublie parfois, mais beaucoup de gens ont commencé à Bruxellons!. Des gens qui font des grandes carrières aujourd’hui et qui ont une renommée certaine. Je crois qu’il a remis à l’honneur le théâtre populaire, pas au sens péjoratif, mais bien au sens noble et vilarien du terme. Au sens de l’époque où Jean Vilar a créé Avignon.
J.C.: Souvent, les gens me disent en parlant de Bruxellons!: «Ici, on ose venir au théâtre». Quand j’entends ça, ça me donne presque les larmes aux yeux. Le théâtre est né sur les places publiques et il devrait rester pour tout le monde. Ça ne devrait être élitiste ni dans le propos ni dans la manière.
Olivier a toujours défendu qu’au festival, on fasse du théâtre de qualité pour le plus grand nombre. Car un message n’a de sens que s’il est entendu. C’est ce qu’on a toujours voulu faire dans la programmation, en mêlant des choses plus populaires à des choses plus pointues.
S.P.: Et je crois que ce qu’il a réussi à faire, c’est que des gens viennent avec de très grosses voitures, prennent le buffet, le champagne, le carré d’or, sortent heureux et qu’en même temps, il y ait quelqu’un qui vit loin, qui s’est battu, qui a pris un petit billet à 1,25€ grâce à un article 27, qui est venu en métro et qui apprécie autant le spectacle que le mec à côté avec sa grosse voiture. C’est sans doute une des plus belles leçons qu’on peut recevoir. C’est la base de l’art.
Tout cela devant My Fair Lady…
J.C.: On espère !
S.P.: Oui, le racisme de classe dénoncé dans My Fair Lady oppose deux classes sociales qui seront, à coup sûr, toutes les deux présentes dans les gradins cet été (sourire).
Interview : Marin Lambert

.png)
.png)




